Plus connectés, plus isolés ? Le paradoxe unissant les réseaux sociaux au sentiment de solitude

Les jeunes adultes sont considérés comme la génération la plus connectée, avec une utilisation des réseaux sociaux qui a explosé au cours de la dernière décennie. Ces plateformes offrent des opportunités inédites pour rester en contact, échanger et élargir ses cercles sociaux. Pourtant, un paradoxe inquiétant émerge : malgré ces possibilités accrues de connexion, les jeunes adultes sont également au cœur de ce que plusieurs appellent l’épidémie de solitude. Selon des études récentes, les jeunes adultes rapportent des niveaux de solitude significativement plus élevés que les autres groupes d’âge (Barreto et al., 2021).
Comment expliquer que des outils conçus pour rapprocher les individus puissent coexister avec un sentiment croissant de solitude ? Peut-on réellement établir un lien direct entre l’utilisation des réseaux sociaux et cette solitude ? Ces questions complexes sont explorées par l’équipe de recherche sur la Santé et le Bien-Être numérique dans le cadre des initiatives Connexion. Nous vous présentons ici le fruit d’une récente recension de la documentation scientifique portant directement sur la relation unissant l’utilisation des réseaux sociaux et le sentiment de solitude chez les jeunes adultes (Légaré et Caron, 2025).
Comprendre la solitude : bien plus qu’être seul.e
La solitude est bien plus qu’une absence de contacts physiques ou sociaux. Elle se définit comme un décalage entre la connexion sociale perçue et celle que l’on désire, que ce soit en quantité ou en qualité (Lisitsa et al., 2020). Autrement dit, même au milieu d’une foule ou en ligne, on peut ressentir un vide social. Ce sentiment peut être ponctuel, mais lorsqu’il persiste, il devient un facteur de risque pour la santé mentale et physique, augmentant les risques de dépression, d’anxiété, et même de maladies cardiovasculaires (Hawkley & Cacioppo, 2010).

L’effet des réseaux sociaux sur la solitude : un paradoxe à double tranchant
Les réseaux sociaux, qui promettent de rapprocher les gens, n’ont pas toujours les effets attendus. Notre revue de la documentation scientifique révèle que la fréquence et l’intensité de leur utilisation jouent un rôle central dans l’expérience de la solitude. Les comportements passifs, comme le défilement incessant des fils d’actualité ou l’observation des publications d’autrui sans interaction, sont particulièrement associés à une augmentation du sentiment de solitude. Ces comportements encouragent souvent la comparaison sociale, qui peut creuser le fossé entre la vie idéale perçue des autres et sa propre réalité.
À l’inverse, un usage actif des réseaux sociaux, comme interagir avec des ami.e.s proches ou partager des contenus authentiques, peut atténuer ce sentiment. Cependant, même les comportements actifs ne garantissent pas toujours des résultats positifs, surtout si les interactions en ligne manquent de profondeur ou ne mènent pas à des relations significatives hors ligne.
L’importance des comportements en ligne : tout est dans la manière
La façon dont on interagit sur les réseaux sociaux influence profondément le lien avec la solitude. Les comportements passifs amplifient souvent les sentiments de vide, tandis que les comportements actifs peuvent aider à créer des connexions plus authentiques. Cela dit, toutes les interactions actives ne se valent pas. Par exemple, commenter des publications ou partager du contenu peut parfois sembler engageant, mais si ces échanges ne reçoivent pas de réponses significatives ou sincères, ils risquent de laisser une impression de déconnexion.
De plus, les intentions derrière l’utilisation des réseaux sociaux comptent tout autant que les comportements eux-mêmes. Utiliser ces plateformes pour valider son image ou chercher l’approbation des autres peut accentuer indirectement le sentiment de solitude. À l’inverse, un usage intentionnel et orienté vers des interactions de qualité peut aider à maintenir un équilibre émotionnel, et prévenir de l’apparition du sentiment de solitude.
Le rôle des plateformes : quand la structure accentue la solitude
Au-delà des comportements individuels, la structure même des réseaux sociaux influence l’expérience des utilisateur.trice.s. Les algorithmes, conçus pour maximiser le temps passé en ligne, favorisent souvent des comportements passifs comme le défilement infini (doom scrolling) ou la consommation de contenu suggéré. Ces mécanismes n’encouragent pas toujours des connexions sociales significatives.
De plus, la valorisation des contenus populaires, souvent mesurée en « likes » ou en partages, renforce une culture de la comparaison sociale. Ces dynamiques peuvent exacerber les sentiments de solitude, particulièrement chez les jeunes adultes qui sont dans une phase de vie où l’appartenance et les relations sociales jouent un rôle crucial dans le développement personnel (Danneel et al., 2020).
Vers une utilisation intentionnelle des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement négatifs, mais leurs effets dépendent fortement de la manière dont ils sont utilisés. Pour contrer l’épidémie de solitude chez les jeunes adultes, il est essentiel d’encourager un usage intentionnel, actif et axé sur des interactions de qualité. Cela implique également de repenser la structure des plateformes elles-mêmes, en plaidant pour des designs qui favorisent les connexions authentiques plutôt que les simples clics et le temps passé.
En savoir plus
Les résultats de ce projet s’inscrivent dans la lignée des initiatives Connexion de l’Équipe SBEN. Ces projets visent à mieux comprendre la relation complexe entre les activités en ligne et le sentiment de solitude accru chez les jeunes adultes. En plus d’explorer les dynamiques à l’œuvre, les initiatives Connexion ont pour objectif de dégager des pistes de solution concrètes pour favoriser un usage numérique plus équilibré et promouvoir un meilleur bien-être social et émotionnel. Pour en savoir davantage sur nos travaux et découvrir nos recommandations, suivez-nous sur nos différentes plateformes et restez à l’affut des nouvelles parutions sur SBEN.ca!
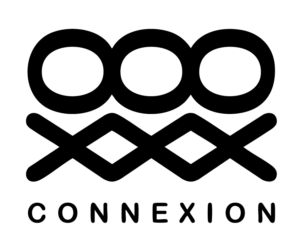
Références
Barreto, M., Victor, C., Hammond, C., Eccles, A., Richins, M. T., & Qualter, P. (2021). Loneliness around the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness. Personality and Individual Differences, 169, 110066. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110066
Danneel, S., Geukens, F., Maes, M., Bastin, M., Bijttebier, P., Colpin, H., Verschueren, K., & Goossens, L. (2020). Loneliness, social anxiety symptoms, and depressive symptoms in adolescence: Longitudinal distinctiveness and correlated change. Journal of Youth and Adolescence, 49(11), 2246–2264.
Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218–227.
Légaré, A-A., & Caron, M. (sous presse). Social media and loneliness among young adults : a scoping review.
Lisitsa, E., Benjamin, K. S., Chun, S. K., Skalisky, J., Hammond, L. E., & Mezulis, A. H. (2020). Loneliness Among Young Adults During Covid-19 Pandemic: The Mediational Roles of Social Mediad Use and Social Support Seeking. Journal of Social and Clinical Psychology, 39(8), 708–726. https://doi.org/10.1521/jscp.2020.39.8.708

